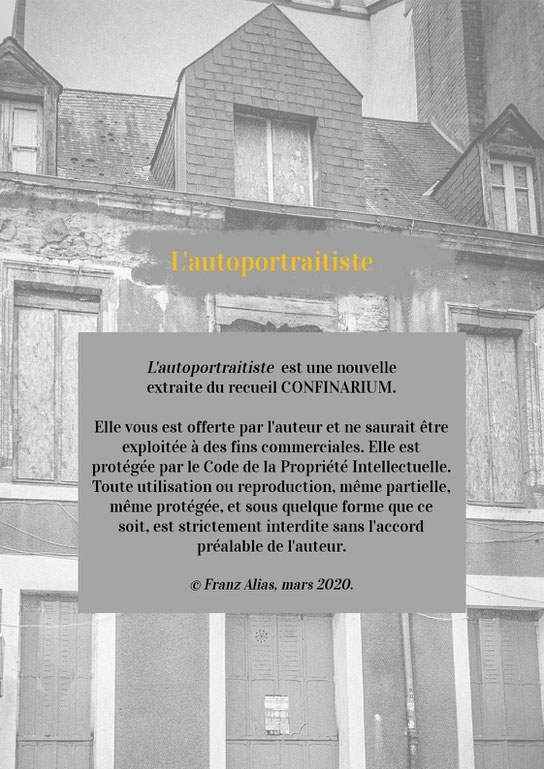L'autoportraitiste
Une nouvelle extraite du recueil « Confinarium ».

Il y avait, au n°13 de la rue Didier Raoult, une des dernières devantures de boutique que l’on avait faites en bois depuis presque un siècle, sauvée on ne savait comment du raz-de-marée de l’aluminium et du plastique qui avait ravagé les façades des magasins de la ville depuis les années quatre-vingt. Composée d’une grande vitrine et d’une porte vitrée étroite, elle avait été peinte et repeinte nombre de fois à tel point qu’elle prit, en l’espace de quelques décennies, plusieurs centimètres d’épaisseur. À l’époque qui nous intéresse, c’est-à-dire lors du Grand Confinement, la façade était d’un rouge vermillon augmenté d’une pointe de gris, ce qui lui ajoutait une discrète profondeur et un aspect non criard.
Il y avait sur le fronton, peint à la main, un lettrage blanc constituant le mot Galerie.
Il y avait, dans cette boutique, une artiste peintre.
Nul n’est besoin de préciser que plus personne n’était autorisé à pénétrer les lieux, au grand désarroi de la propriétaire, et sans doute des amateurs d’art. La question de fermer ou non les rideaux n’était pas venue à l’esprit de Lesquice. Elle continuait d’exposer ses petites toiles dans la vitrine, d’éclairer le soir, de les remplacer à tour de rôle, comme si rien n’avait vraiment changé. La journée, dans son grand atelier lumineux jouxtant la galerie, l’artiste reprenait les toiles qui n’étaient pas cirées ou vernies. Une note de couleur ici, un trait là, l’accentuation d’une ombre, l’œuvre ne manquait jamais d’être améliorée, à l’instar de la ponctuation d’un texte qu’il était toujours possible de reprendre. Mais il s’agissait-là de gagner du temps.
En effet, Lesquice était confrontée à deux problèmes majeurs : le manque de toiles vierges et l’impossibilité de sortir. Ne pas pouvoir en acheter n’était pas le plus critique des deux (il était toujours possible de recouvrir une toile de peinture blanche et de la recommencer si le jugement sévère de son œil expert la poussait à considérer que cette croûte s’éloignait trop du chef-d’œuvre), non, l’enjeu concernait davantage les sujets à peindre. Elle s’était malgré elle fait une spécialité, et un renom international, dans la peinture automobile. Non qu’elle fût carrossière, la tôle ne l’intéressait que par son aspect plastique.
Le principe de son art consistait à interpréter les volumes, les courbes et les reflets des véhicules automobiles qui évoluaient par les rues et sous ses yeux en même temps qu’il acquérait cette précision et cette grâce mécanique dont le milieu des galeristes et des collectionneurs d’art ne cessait de glorifier. Ses toiles, dont le gigantisme faisait dire à certains critiques qu’il n’avait d’égal que le talent de l'artiste, étaient exposées dans nombre de capitales. Les chromes étincelants de ses calandres artistiques avaient été vus à Paris, Londres, Berlin ; la luisance de ses coquilles, dans leur acception carrossière, admirée à Moscou, Pékin, Riyad… Le monumental hall de la gare de Tokyo, l’entrée du grand auditorium du Parlement Européen, l’une des éminentes galeries du Metropolitan Museum of Art de New-York, tels étaient certains de ces lieux prestigieux qui avaient eu le bon goût de reconnaître dans l’art de Lesquice génie et dextérité. Aucune concession ni écurie automobiles, pas même le plus modeste garage provincial, n’aurait osé s’abstenir de posséder la reproduction d’une de ses toiles. Un journaliste avisé, dans un article du Times consacré aux influences majeures sur la vie de nos contemporains de la classe opulente, l’avait surnommée, non sans une certaine fantaisie, l’Auto-Portraitiste. On ne quantifiait plus la multitude de peintres opportunistes qui se revendiquaient de son art, à tel point qu’il fut établi qu’un nouveau courant pictural était né de son travail : « l’Automobilisme ».
Elle avait toasté un nombre incommensurable de coupes de Champagne dans les maints vernissages qui l’avaient accueillie comme une star de cinéma à travers le monde. Elle n’avait eu de cesse de conceptualiser son art dans les discours nécessaires qui les accompagnaient, s’était gargarisée de justifications artistiques, enivrée de théories intellectuelles en robes du soir, gorgée de blablas inconsistants, farcie de hâbleries, gonflée d’égocentrisme, de rires forcés, de faux échanges et d’aspirine à tel point qu’elle disparut un jour de la circulation, abattue, brisée, anéantie, et libre. Dégagée des trop lumineuses représentations, des luxueuses chambres d’hôtel dépourvues d’esprit, des décalages horaires intempestifs qui avaient fait d’elle un être qu’elle n’était pas, et de tous ces assistants perpétuellement en état de flagornerie qu’elle avait tous renvoyés, sans omettre de verser à chacun de substantielles indemnités, dégagée donc de l’étau qu’était devenue sa vie, elle s’était retrouvée une âme. Seul son mari avait eu la faveur de rester auprès d’elle, mais dans quel état.
Lesquice s’était ainsi exilée loin de cette futile agitation, et avait acquis cette petite boutique à la devanture rouge, dans une rue calme d’une modeste ville montagnarde des confins de l’est, à mille lieux de toute esbroufe conceptuelle. Le logement était constitué de deux étages et se situait au-dessus de l’atelier. Là, entre ses pinceaux et les promenades dans les pâturages, elle avait repris peu à peu contact avec l’essentiel, les choses simples, les ambiances vraies, les individus. Ses anciens collaborateurs n’en seraient pas revenus s’ils l’avaient vu déambuler ainsi par les rues tortueuses, un cabas fleuri au coude, tout sourire, acheter ses légumes elle-même au marché, le samedi matin, sous la halle municipale. Elle avait tiré un trait sur les gigantesques toiles qui avaient fait son succès, se contentait de formats que les murs des maisons riveraines étaient en mesure de recevoir, et avait scandaleusement réduit ses prix à la faveur des portefeuilles des résidents auprès desquels sa renommée internationale n’était pas parvenue. Le souvenir de l’inconsistance que représentait sa vie révolue la faisait parfois éclater d’un rire acrimonieux lorsqu’elle tournait le verrou et ouvrait en grand la porte vitrée de sa petite boutique rouge.
Seule la santé de son mari bien-aimé apportait une ombre au tableau de leur nouvelle vie paisible. Sans doute avait-il lui aussi trop souvent lutté contre cette existence surchargée, sans doute lui eut-il fallu vivre un nombre plus réduit d’années électriques, de tourbillons infinis, de turbulences sonores, de brouhahas cycloniques : il était victime d’une forme spectaculaire de ce qu’il avait été convenu de qualifier d’« amorphie excessive », une sorte d’aliénation des intentions, comme une incurie pathologique qui l’aurait installé dans une indifférence absolue, une nolonté caractérisée. Apathique de jour comme de nuit, il passait le plus clair de son temps allongé dans le lit de sa petite chambre, le regard au plafond, vide d’envie et creux d’émotions, dans une torpeur sans fond. Le couple avait dû se contraindre à dormir dans des chambres séparées, lui ne supportant plus la lumière dont elle se servait pour sa lecture du soir, elle déchirée de ne plus rien éveiller en lui lorsqu’elle ôtait ses habits du jour. Parfois le croisait-elle en pleine nuit, l’espace d’un instant, incarnant l’ombre d’une silhouette fantôme, à peine consistant, résolument transparent. Lesquice venait lui caresser le front et la joue, un sourire tendre accroché à la tristesse qu’elle ressentait de ne pas pouvoir encore partager avec lui cet autre versant de leur vie atypique. Elle avait bien tenté toute sorte de traitements médicamenteux, de stimulants alternatifs, de substituts aux plantes, sans parler du soutien sincère et quotidien dont elle l'enceignait autant qu'il lui était possible. Elle n’omettait pas non plus de l’inclure dans ses activités, et montait souvent les étages pour lui conter, essoufflée, telle anecdote de la boutique, la réaction saugrenue de cet enfant devant ce pot d’échappement multicolore, ou cette petite toile, tu sais, l’Enjoliveur Pourpre, qu’elle s’était fait une joie de vendre à une mémé contre une bouchée de pain. Mais il semblait que rien ne pût aider son amoureux à s'extraire un instant de cette léthargie extrême. Conscients sans doute tous les deux, ils n’en étaient pas moins démunis. Jamais elle n’eut l’idée de le traiter de grosse feignasse.
Deux problèmes majeurs se présentaient donc à Lesquice ce jour-là. S’il était convenu que celui des magasins proposant des toiles vierges à la vente, et subissant eux aussi l’interdiction d’ouvrir leurs portes, n’était pas le plus fâcheux, il n’en restait pas moins que le stock de la peintre s’était affaibli de façon critique. Elle allait devoir faire des choix de recyclage ou dénicher d’autres supports. Mais la préoccupation primordiale qui l’assiégeait pour l’heure était sa propre résignation à résidence. Comment parvenir à créer une nouvelle œuvre, qui ne soit pas une redite, en ne pouvant pas s’inspirer des éléments automobiles extérieurs ? Les affres de la création procèdent de toute interdiction, c’était du moins ce qu’elle ressentait, le nez derrière la vitre de sa petite porte verrouillée. Les véhicules stationnés devant sa vitrine l’étaient depuis trop de temps déjà, et rien en eux n’attisait plus chez Lesquice une quelconque inspiration créative. Les artistes vous le diront : l’inventivité nait le plus souvent de l’innovation du regard. Entravée par cette idée de réclusion, l’artiste en perdait sa faculté de distanciation, elle ne parvenait plus à prendre du recul sur les choses qui lui permettait de les voir différemment, de les interpréter.
Pour la première fois depuis très longtemps, Lesquice, dans son grand atelier désert, se sentit seule.
Elle reposa sur sa planche la brosse dont elle s’était servie pour donner un dernier effet moiré à une énième reprise de toile, et alla se vérifier l’existence par l’entremise d’un courrier glissé dans la fente à lettres de la porte d’entrée. Rassurée mais déçue, elle déchira l’enveloppe et rangea la facture parmi le tas de courrier à traiter. Elle s’interrogea sur la pertinence de payer celle-ci, qui correspondait à l’usage de son petit commerce fermé depuis déjà quelques semaines, et prit le soin de bien laver ses mains, au cas où un résidu viral avait eu la mauvaise idée de s’agripper à l’enveloppe. Elle jeta par réflexe un coup d’œil à travers le miroir qui surplombait le lavabo et se ramena une mèche de cheveux derrière l’oreille. Bien qu’elle ne fût plus coutumière de sa propre inspection depuis son changement radical de vie, Lesquice prit le temps d’observer son reflet, circonscrit qu’il était par le bois ciselé du cadre. L’examen prit quelques minutes, l’artiste prenant tantôt une pose de profil, un recul, une posture altière, les bras croisés ou une main perdue dans l’envers de la chevelure. Elle approfondissait l’étude en ne la limitant pas au visage, le cadre du miroir signifiant son propre morcellement. La question ne concernait pas le sujet, elle avait depuis lors bien dépassé le stade de l’auto-complaisance, non, il s’agissait de se rendre compte, tout simplement, du potentiel artistique d’une telle représentation. Lesquice était en train de retrouver cette distanciation qu’un créateur se doit de disposer sur les choses s’il souhaite en émettre une vision personnelle. Elle était la chose, le sujet-même de l’étude. Une fois franchie l’étape schizophrénique de la démarche, elle n’en revenait pas de constater l’évidence d’une telle possibilité, et s’étonnait de n’y avoir pas songé plus tôt. « L’âme de ma tronche vaut bien celle d’un rétroviseur », s’adressa-t-elle non sans une pincée d’ironie.
Elle se hâta d’annoncer la nouvelle à son mari, qui ne manqua pas de lui transmettre par le regard toute l’atonie dont il disposait.
L’atelier était spacieux, il avait été construit sur un seul niveau à l’arrière de l’immeuble. Une grande verrière venait le remplir de lumière à l’inverse de la galerie que Lesquice, dans un souci d’accessibilité intellectuelle, préférait nommer boutique. Il n’était plus question pour elle d’adhérer à cette théorie qui consistait à entretenir le principe que le simple mot « galerie » devait rebuter une sérieuse tranche de la population pendant qu’une autre, plus petite, s’en gargarisait. Lesquice abhorrait désormais l’idée que l’art se dût de n’être accessible qu’à une élite sociale, financière et très hautement pédante. Elle en était revenue, et affirmait que rien ne justifiait un tel concept. Et lorsqu’une personne osait franchir la porte en demandant s’il était possible de voir et s’excusant presque, par le fait même de poser la question, de ne pas être dans la possibilité d’acquérir, Lesquice ne lui lançait point son dédain à la figure, au contraire, elle venait la rassurer, et une conversation s’engageait sur la légitimité que nous avions tous à apprécier, ou non, tel ou tel tableau. Au « j’y connais rien », elle répondait qu’il n’était pas indispensable de savoir le solfège pour apprécier la musique. Et elle invitait la personne à prendre le temps d’accueillir ses toiles en lui disant qu’il était nécessaire de se mettre dans une posture de réception. Ainsi, peut-être une d’entre elles aurait-elle la faveur de lui plaire, de l’émouvoir, de lui favoriser une pensée, de lui éveiller un sentiment, un souvenir, une réflexion. « Vous savez, il est possible de se troubler sur deux vers d’un poème qui en contient mille, de se les approprier en se fichant complètement du sens que le poète a souhaité donner, et de les garder pour soi, comme un trésor personnel qu’on est seul à posséder. » Toute la beauté de l’art, pour Lesquice, n’était pas dans ce qu’il était en mesure de montrer mais dans ce qu’il était capable d’éveiller. Elle ajoutait que la réussite d’un tableau reposait sur pas grand-chose, qu’elle ne résidait que dans la rencontre, le plus souvent fortuite, entre celui-ci et une individualité. La discussion prenait parfois la voie du potentiel aspect décoratif de l’art, à quoi Lesquice répondait qu’elle n’y émettait aucune objection, que de toute façon, le mieux pour bien vivre était de s’entourer d’art, quelle que fût la raison évoquée à la volonté d’en posséder. Et à la question de l’accessibilité, elle répondait que s’il était vrai qu’une certaine classe, aidée par des décennies d’appropriation de la part de galeristes soucieux de ne pas perdre leur commerce, estimait que l’art se devait d’être entouré de garde-fous monétaires, elle, aujourd’hui, considérait que c’était du crétinisme. Et si le mot « galerie » avait été choisi pour illustrer la fonction du lieu, peint sur le fronton de la devanture, c’est parce qu’il n’y en avait pas de plus explicite. L’art étant la nourriture de l’âme, elle n’omettait cependant pas d’informer son interlocuteur de l’existence, dans ce présentoir, de toute une collection de petites œuvres originales sur papier, non encadrées, disponibles pour moins que le prix d’un gigot d’agneau.
Sauf que la boutique était déserte, et de telles discussions, l’artiste n’en avait plus depuis belle lurette, depuis que la seule solution qui restait aux responsables gouvernementaux n’était plus de mettre leurs têtes dans un trou mais d’y inclure nos corps entiers.
Il fallut à Lesquice pas moins d’un quart d’heure pour trouver la position parfaite du miroir, celle qui convenait à sa physionomie sans qu’elle ne gênât ses gestes. Posé sur un chevalet face à elle, il était un peu décalé vis-à-vis du deuxième support qui soutenait la toile à peindre. La mise en scène, pour l’artiste, s’avérait cocasse. Non seulement il semblait qu’elle peignît deux tableaux en même temps, mais il lui était troublant de se voir interpréter le rôle du peintre en même temps qu’elle jouait celui du modèle. Tout ceci était très nouveau et ne manquait pas de fantaisie.
Elle avait choisi au préalable de recouvrir cette paire d’essuie-glaces, non qu’elle les eut jugés mal faits, elle s’était amusée de la symbolique que le geste représentait, bien qu’elle fût consciente de n’être jamais que la seule personne à le savoir. Puis elle s’était lancée, troublée tout de même de devoir faire preuve d’une observation aiguë de son propre reflet avant d’en pouvoir dessiner les contours. Elle s’allégeait l’égocentrisme en s’autorisant à penser qu’il n’en était rien et qu’elle n’avait de toute façon pas le choix du modèle. Le confinement la posait là. Elle n’allait tout de même pas peindre l’amorphisme de son mari, l’âme qu’elle souhaitait inclure dans les yeux de son sujet n’était pas celle d’un bovidé. L’instant d’une seconde vint à son esprit l’image de son mari représenté en minotaure, elle s’en émoustilla, saisie par la majestueuse force que la vision soulevait, soupira longuement, puis reprit sa concentration.
Les lignes de contour désormais tracées, Lesquice entamait les choses sérieuses. Elle prit dans son coffret à tubes celui qui correspondait à sa couleur de peau, appliqua la substance sur la toile et l’étala avec les doigts. Elle aimait cette technique pour ce qu’elle contenait de sensualité, l’usage conventionnel du pinceau représentant une entrave à la relation qu’elle souhaitait entretenir avec la matière. Ce côté tactile, qui la rebutait dans les relations aux gens, comme une intrusion dans son aura, exaspérait ses émotions lorsqu’il s’agissait de son art. L’ombre que seuls ses doigts étaient en mesure d’effectuer parvenaient à donner à la surface plate l’illusion du galbe de la joue. Ses doigts alternaient dans une sorte de chorégraphie silencieuse la pose d’une couleur et le traçage d’un effet. Elle s’étonnait elle-même de la facilité qu’elle éprouvait à représenter une peau bien qu’elle n’eût exécuté jusqu’alors que des portraits automobiles. Mélangeant les techniques, appliquant des pigments purs sur les surfaces périphériques, recourant à des crayons pour renforcer une ligne ou des feutres pour figurer un cil, elle fixait le tout à la bombe au fur et à mesure de son exécution, accélérait le séchage au sèche-cheveux, se tamponnait le coquillard des règles académiques, éclaircissait une sombreur en la badigeonnant d’une sorte d’enduit de sa composition, repassait du brun, du rose, du vert, de l’ocre, du noir, du mauve, du jaune ou du blanc, effaçait du pouce une ligne, reprenait une arête, rougissait une lèvre, arrondissait la sclère, ouvrait la pupille, et lorsqu’elle apposa une fine goutte de blanc sur l’iris de l’œil, elle eut la sensation, non pas de mettre le point final à une phrase, mais d’insuffler un souffle de vie à la représentation d’une âme.
Elle se leva d’un bond en bousculant son tabouret, examina la toile avec recul, ne sut qu’en conclure, baissa les yeux sur son mollet, et s’aperçut que son bas avait filé de même que la journée.
Il fallait à l’artiste une nuit entière d’extraction mentale pour être en mesure de juger si l’œuvre était digne d’être supportée par son regard ou si elle n’était qu’une immonde croûte. Dès son réveil, elle se hâta donc de mettre à profit la lucidité de son appréciation en dévalant les escaliers jusqu’à l’atelier. La toile était là, posée sur le chevalet, en plein milieu. L’artiste fut rassurée, point n’était nécessaire d’être expert pour se rendre compte qu’on avait affaire à un chef d’œuvre.
Ni une ni deux elle fonça à la cave démonter l’armoire normande qui ne servait plus qu’à stocker du vieux matériel inutile. Après quelques forts coups de marteau, elle parvint à faire tomber un des côtés et le remonta dans l’atelier. Ce support tout en longueur allait lui permettre de se peindre en pied. Elle ne manqua pas d’en applaudir la perspective et s’activa à badigeonner la planche de peinture blanche, de vieux journaux et d’enduit. Il ne restait plus qu’à attendre que le séchage opérât.
En revenant se positionner devant l’œuvre de la veille, elle songea au qualificatif dont l’avait affublée ce critique d’art à l’époque, c’est-à-dire l’avant-veille, où elle exerçait encore dans la peinture automobile. Elle considéra avec amusement qu’il pouvait demeurer applicable. Puis elle s’étonna de se trouver face à elle-même. Le portrait était réussi, tant sur le plan plastique que sur celui de la ressemblance, il semblait même être vivant. Quel dommage, pensa Lesquice, que personne ne fût là pour le constater et s’en réjouir. Non pas qu’elle voulût témoigner une quelconque arrogance de l’avoir créé, elle estimait simplement fâcheux que la contemplation de l’œuvre elle-même ne profitât à personne. Imaginons que la partition achevée du Requiem de Mozart n’ait jamais été livrée, ou pire, que fût restée sur son étal la banane de Cattelan…
Les journées confinées de Lesquice furent alors remplies d’excitation, de peinture et de tâches. Elle préparait ses toiles et à manger, balayait les contours et les planchers, lavait ses pinceaux et son mari, et laissait se reposer le tout quand elle pouvait. Dotée d’une volonté redoutable, elle surpassait les contraintes et les difficultés en leur inversant la charge. Le plaisir qu’elle prenait dans son travail lui permettait de s’alléger du reste. Tous les supports plats qu’elle pouvait dénicher lui étaient ainsi propices à se tirer le portrait, de pied en cap pour certains, car elle aimait l’idée de se peindre aussi à échelle humaine. L’atelier fut rapidement saturé de monde.
Un jour qu’il faisait chaud, elle ôta ses vêtements et se peignit nue.
Une semaine plus tard, elle entreprit de ranger l’atelier, il n’était plus possible de s’y déplacer sans bousculer quelqu’une. Elle déposa des toiles dans le logement du couple, à tous les étages : quatre dans le salon, deux dans la cuisine, une dans la salle de bain, une sur le palier de l’escalier, trois dans sa chambre, etc. Elle décida, non sans une certaine malice, de placer le nu dans la chambre de son mari qui n’y prêta, comme à l’ordinaire, pas plus d’intérêt que celui qu’il offrait aux poutres du plafond.
Un nuit, Lesquice fit un rêve érotique dont les sensations et le plaisir lui parurent au réveil d’un réalisme troublant. Elle enfila une robe de chambre sur sa chemise de nuit et pénétra dans l’antre de son mari, encore ébranlée par le souvenir de cette douce nuit voluptueuse. Il se tenait là, sur le dos, comme à l’accoutumée, mais ronflant comme jamais, un imperceptible rictus au coin des lèvres semblant trahir une aise insolite. Elle n’osa pas le réveiller.
Le portrait se tenait en face de lui, là où l’artiste l’avait placé quelques jours plus tôt. Nez à nez avec elle-même, Lesquice estima qu’il était particulièrement réussi, le rose qu’elle lui avait mis sur les joues lui donnant une mine radieuse et l’éclat dans les yeux comme une intention coquine. Elle traduisit cette impression par l’influence de son souvenir nocturne et sortit de la chambre.
La journée durant, occupée à chaque instant par toute chose plus ou moins artistique, Lesquice se demanda si son mari n’était pas venu la rejoindre dans son lit la nuit dernière et n’avait pas abusé de la profondeur de son sommeil. Mais cette idée, bien qu’elle fût partagée entre l’infaisabilité de la chose, l’excitation de la démarche, et la turpitude de l’outrage, l’artiste la ressassait malgré elle à telle point qu’elle ne sût plus comment s’en défaire. Et tandis qu’elle vernissait une de ces dernières toiles, l’esprit perdu dans les limbes de la volupté et de la frustration, Lesquice sentit des picotements monter progressivement de l’intérieur de son corps. Les battements de son cœur s’accélérèrent, elle eut la sensation d’un afflux de sang dans tous ses organes en même temps qu’une douce flamme l’envahissait. Incapable de contrôler ces fortes perceptions qui s’insinuaient dans les moindres recoins de son corps et le faisaient gonfler, Lesquice sentit sa peau se sensibiliser d’une façon singulière comme si des mains divines venaient la frôler, l’envelopper de chaleur, et lui en caresser toute la surface. Lorsqu’elle eut la sensation qu’on lui tripotait les seins, elle courut vers l’escalier et entreprit d’en gravir précipitamment les marches. Chaque enjambée lui brûlait l’entrecuisse et jamais la montée des étages ne lui parut si longue ni si profonde l’impatience de parvenir au dernier. Plus elle évoluait dans l’ascension, plus l’émoi était fort et l’excitation puissante. Le souffle court, la respiration saccadée, la peau moite, ne se sentant plus elle-même, elle parvint au palier des chambres et, les yeux fermés, elle ouvrit brutalement la porte dans un dernier cri de jouissance.
Elle leva les yeux. Son mari était là, allongé sur le lit, un regard ébahi tourné vers elle. Mais le plus étrange était qu’une femme nue le chevauchait. Une femme qui n’était autre qu’elle-même.
− Je le savais ! lança Lesquice après qu’elle reprit ses esprits, que l’émoi fut apaisé, et que le portrait réintégra sa toile. Mais ce qui m’étonne quand même, c’est de te voir dans cet état, mon chéri.
Elle s’approcha du lit, s’assit sur le bord, couvrit son mari du drap et lui épongea le front. Ce dernier lui expliqua qu’il ne comprenait pas, qu’il avait l’impression d’être sorti d’une nuit longue, lui conta cette sensation de tourbillon sans fond, d’abîme, de cloaque et de réveil soudain, avec elle. Ses sourcils se froncèrent d’un coup.
− Mais… attends…
Il donnait l’impression de fouiller ses souvenirs, de sonder les tréfonds de son esprit, sans vraiment parvenir à clarifier sa pensée.
− Je crois t’avoir vue là, près de la porte,… mais non, en fait tu étais avec moi… Oh… Mais… Nous faisions l’amour, ma chérie ! Est-ce possible ?
− Oui, dit Lesquice, c’est à peine croyable…
Elle tourna son regard vers le portrait, partagée entre la stupéfaction d’une telle situation et l’intuition de l’avoir toujours su. Un sentiment de trahison la traversait sans qu’elle pût distinguer s’il la plaçait en victime ou en coupable, nonobstant le fait qu’elle était encore émue par la puissance et l’amplitude de son orgasme, qu’elle prit seule, cela ne faisait pas de doute, mais avec les mêmes sensations que si elle ne l’avait pas été, peut-être même doublement. C’était confus, somme toute.
Son mari, qui reprenait peu à peu conscience de son état et de la manière qu’il avait eu de s’extraire de cette somnolence incarcérante, lui expliquait qu’il ne comprenait toujours rien. Il s’était soudain senti envahi par une chaleur douce et progressive, apaisante aussi. Plus il avait accueilli cette bienveillance qui prenait consistance dans sa chair, plus l’émotion avait pris de l’ampleur. En lui était montée une bouffée de joie, pleine de rondeur, mêlée à une effervescence lacrymale. Un mélange de pleurs d’enfant et de félicité. Une lumière immense qui avait tout submergé, des couleurs magnifiques partout autour, le sentiment d’une paix parfaite, un réconfort enveloppant, l’impression que tout était uni, que tout ne formait qu’un. Il s’était vu lui-même accueillir cette extase comme un cadeau qu’il ne pouvait refuser, avec délice et jouissance, libéré d’un poids immense et rempli d’un amour infini. Et devant lui, à travers cette lumière superbe, il y avait Elle, belle comme jamais, l’incarnation physique de toute cette plénitude merveilleuse et entière qui lui offrait… la Vie. Elle était venue le voir, comme sortie d’une image, un bras d’abord, tendu vers lui, puis une épaule, une jambe, sa poitrine superbe, ses hanches rondes, elle s’était approchée, et dans une offrande de tout ce qu’elle représentait, elle s’était unie à lui dans le partage, le don et l’amour, en ne formant à eux deux qu’une et une âme.
Quel génie avait-il bien pu la traverser ?
− Mon amour…, dit-il dans un souffle.
Lesquice l’écoutait avec admiration. Que son mari fût extrait de sa léthargie grâce au portrait peint par elle et non à tous les soins qu’elle n’avait cessé de lui prodiguer au cours des derniers mois la plaçait dans une perplexité visible. Mais ses sentiments étaient bons, elle pensa que tomber amoureux de son portrait n’était pas plus, ni moins, que de l’aimer aussi. Elle trouva l’idée poétique.
− Tu parles d’une aventure ! lança-t-elle sans qu’il fût possible de savoir si elle parlait de l’ensemble de la situation ou seulement de la maîtresse de son mari.
− Viens voir, il y en a d’autres.
À ces mots le mari sauta du lit, enfila un slip et suivit sa femme en lui prenant la main.